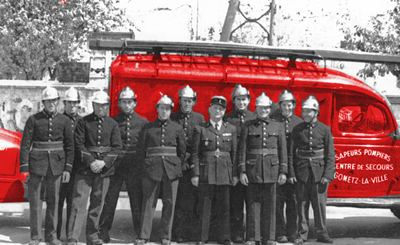Les travaux des champs au rythme des saisons

Contenu de la page
Les ouvriers agricoles
Dans les champs chacun avait sa spécialité. Ainsi il n’était pas possible de donner une binette à un charretier; la hiérarchie était respectée. Du printemps à l’hiver la campagne vivait et chantait dans toutes les directions. L’homme, le cheval et l’outil ne faisaient qu’un. Chaque charretier avait ses chevaux, il conduisait son attelée et labourant avec sa charrue. Son fouet lui appartenait en propre; quand un charretier quittait son patron, on le voyait s’en aller son fouet sur l’épaule.
Chacun sa fourche ou son fouet
Chacun avait sa fourche ou son broc pour charger les gerbes ou le foin, sa binette pour dégarnir les betteraves, etc… A la sortie de l’hiver quelques engrais étaient épandus à la main; très peu car il y avait énormément de fumier. Les semis de printemps étaient effectués: les avoines les orges, les petits pois, les betteraves, les pommes de terre. Puis, plus tard, les haricots, lorsque la terre était bien réchauffée, sans oublier les parcelles réservées à la nourriture des bêtes de la ferme. Vesse, trèfle, maïs, luzerne, et avoine constituaient le pétrole vert
Les tâcherons
Alors apparaissaient les tâcherons (des Bretons en général). Ils venaient faire les tâches de printemps: biner, dégarnir, butter les pommes de terre et faire les foins en juin. Bien souvent ces tacherons restaient pour faire la moisson s’il y avait entente avec le fermier. Pour ce travail venaient aussi des équipes de Belges qui arrivaient avec leur sape et leur crochet (petite faux sans manche qui se liait au poignet). Ils étaient très durs pour l’entente et si la paye ne leur convenait pas, ils déclaraient forfait dans l’heure.
La moisson
A l’époque de la moisson – grand moment dans le cycle de l’agriculture – la plaine qui paraissait endormie, écrasée par les ondes de chaleur dégagées par les grains mûrs, se réveillait soudainement. Des équipes d’ouvriers, la faux à l’épaule, attaquaient les parcelles d’un mouvement lent, pareil à celui d’un balancier. Ils se suivaient dans un ensemble parfait. Le crissement de la lame coupant le chaume entraînait les hommes. Derrière eux venait une autre équipe qui formait les gerbes en les attachant avec des liens de paille; femmes et enfants suivaient pour dresser les « dizeaux », groupements de dix gerbes dont les épis étaient dressés vers le haut pour que le grain sèche, et que la pluie s’écoule plus facilement. Alors les champs, à perte de vue, s’habillaient de toutes ces gerbes. Lorsque toutes les parcelles de grains étaient coupées, les gerbières arrivaient, attelées de deux chevaux. Les gerbes s’entassaient, montées par deux « broqueurs » et reçues par le « tasseur », qui se faisait une fierté de bien dresser ses gerbes car si par malheur, au détour d’un chemin cahoteux, son chargement venait à tomber, tout le pays en causait et riait du maladroit.
La fête de la moisson
Tout ce chargement venait s’entasser dans les granges ou était mis en meule à l’extérieur. Un bon mois était nécessaire pour effectuer tous ces pénibles travaux. Les journées étaient longues de 12 h. au minimum. La fin de la moisson était marquée par une fête. Sur la dernière voiture de grains rentrant à la ferme, on plantait un « mai » (branche d’arbre décorée de fleurs et de rubans). Puis un grand repas réunissant tout le monde de la ferme était pris en commun. C’était « la passée d’août » qui se terminait fort tard accompagnée de chants et autres histoires, et fortement arrosée. La moisson, moment crucial du cycle de l’agriculture, était ainsi terminée.
Les travaux d’automne
Suivait l’automne et ses récoltes de betteraves et de pommes de terre. Sur la plaine les betteraves fourragères avaient un rôle nutritif pour les troupeaux de vaches et de moutons. C’était la nourriture d’hiver. Elles étaient coupées avec un coupe racines puis mélangées à de la balle de paille. Les betteraves sucrières étaient peu cultivées dans la région pour une raison toujours d’actualité, l’absence de sucrerie proche. Sur des communes voisines on cultivait cette plante pour faire de l’alcool car certaines grosses exploitations y avaient leur usines de distillerie personnelle. On peut se souvenir des trois fermes équipées ainsi, celle de Mr Bouvrin à Villeziers, celle de Mr Dupré à Courtaboeuf, (devenue le siège social de la SAMBOE et du restaurant le Poulailler et celle de Mr Jalleras à Courtaboeuf occupée actuellement par le centre de sapeurs-pompiers des Ulis. Toutes trois ont cessé leurs activités dans les années 50, pour laisser la place à la ville des Ulis et sa Zone industrielle.
Les pommes de terre
La récolte des pommes de terre, toujours très cultivées sur notre plaine, se faisait à cette époque sur de petites superficies, car il fallait faire tout ce travail à la main. Au fil des années et surtout lorsque les premières arracheuses mécaniques, tirées par des chevaux, firent leur apparition, les surfaces augmentèrent considérablement. Les pommes de terre de notre plaine étaient assez réputées pour leur saveur gustative. Le ramassage s’effectuait à la main et bon nombre de familles de Gometz venaient participer aux travaux.
Le geste du semeur
Après toutes ces récoltes, arrivait l’époque des semis. Bien avant la modernisation de ces travaux, les semis étaient faits à la main, à la volée sur le labour. Qui n’a pas entendu parler du geste du semeur ? Pour lancer le grain en tenant compte du vent afin de ne pas « barrer » ( semer trop large en doublant), le geste du bras s’accompagnait d’un pas lourd et cadencé: c’était un art ! Notre génération a appris ce geste en l’effectuant dans notre jeunesse, il ne sera plus transmis ni perpétué.
Au moment des semailles, après la soupe le soir, on allait « vitrioler » ce qui consistait à préparer la semence pour le lendemain. C’était le traitement du grain qui existait déjà à cette époque. Il se faisait à la pelle de bois (pour ne pas casser les grains); face à face on retournait la semence en joignant nos pelles à chaque mouvement. On répétait cette opération deux ou trois fois pour bien humecter tous les grains de blé. Quand le travail était terminé, on faisait la « croix » sur le devant du tas avec le manche de la pelle; chez nous cette tradition a toujours été respectée.
A la suite des semailles qui marquaient la fin des gros travaux avant l’hiver, il y avait l’épandage du fumier. Chargé à la fourche dans des tombereaux, le fumier était transporté dans les champs. On s’évertuait à bien aligner les tas à distance régulière tous les 6 ou 7 mètres. Les constituer, s’appelait « une chaine ». Le plus pénible était d’étaler ou « écarter » les tas de fumier. C’est-à-dire d’épandre le plus régulièrement possible en secouant la fourche pour le disperser avant de l’enfouir au labour.
Les travaux d’hiver
Suivaient les labours qui occupaient les charretiers une bonne partie de l’hiver; cela s’appelait « labourer à mars ». Les charretiers dignes de ce nom s’évertuaient à tracer des sillons rectilignes et à bien « dérayer » (terminer un champ) le long d’un voisin ou d’un chemin. C’était une tâche très lente. Aujourd’hui un tracteur équipé d’une charrue moderne de 4 socs peut labourer 5 à 6 hectares par jour; à l’époque des chevaux, une bonne attelée pouvait faire 0.25 hectare. Aussi tout l’hiver, hormis les jours de grand froid, les attelées labouraient sans cesse.
Le battage
Lorsque ces froids arrivaient durs et piquants, le personnel était employé aux battages de la récolte engrangée durant la moisson. Au début du siècle, bien avant l’arrivée des batteuses, le battage des blés et des avoines se faisait à l’aide de fléaux. Sur une aire de terre battue, réservée à cet effet, les gerbes étaient déliées, étalées, puis les batteurs frappaient en cadence. Un bruit sourd accompagnait le martèlement continu dans une atmosphère de poussière incessante. On retournait la paille avec le manche du fléau pour en battre l’autre face. On secouait la paille avec une fourche en bois pour séparer le grain de la paille. Le battage au fléau était très fatigant, il fallait le lever en moyenne trente sept lois par minute et le faire tomber chaque fois avec force (pour une journée de dix heures, le batteur frappait environ vingt deux mille coups. Il fallait huit à dix jours pour battre la récolte d’un hectare. (Une moissonneuse batteuse aujourd’hui récolte, selon l’importance de la machine, plusieurs hectares par jour).
La modernisation des tâches
Puis vint l’époque de la modernisation. Dans le battage, des trépigneuses apparurent. Elles étaient entraînées par un cheval qui marchait sur un plan incliné composé d’un tablier sans fin, articulé et tournant sur lui-même. C’était un travail pénible pour cette bête. Certains chevaux étaient récalcitrants pour ce genre de travail, mais pour les hommes c’était déjà un gros progrès.
L’arrivée des batteuses « modernes » que l’on peut voir fonctionner dans les fêtes de l’agriculture fut une révolution, peut-être autant que l’arrivée des moissonneuses batteuses actuelles. Au début, seules quelques fermes possédaient leur matériel, c’étaient des batteuses de petite et moyenne importance. L’hiver se passait autour de ces engins à battre une partie de la récolte. La poussière volait drue, tout le personnel était réuni pour alimenter la machine. Pour les autres fermes qui ne possédaient pas de batteuses (ou pour battre le surplus qui n’avait pas été fait) l’entrepreneur était appelé. L’arrivée de la « batterie » était un événement.
C’était un véritable train routier qui se composait de la batteuse, d’une énorme presse et d’une remorque où s’entassaient divers matériels pour les besoins du chantier, le tout tiré par un tracteur (un mono cylindré) qui laissait échapper fumée et décibels en quantité. Le tracteur faisait ensuite tourner tout l’ensemble à l’aide d’une grande courroie. Avant que les tracteurs n’arrivent c’était une locomobile qui entraînait le matériel; cette machine à vapeur a encore fonctionné ici à Gometz au début des années 40.
La main d’œuvre était encore nombreuse, malgré la mécanisation. L’équipe commandée par le chauffeur comprenait une quinzaine de personnes qui avaient chacune leur place. Les « gars de batterie » se reconnaissaient à leur mouchoir à carreaux noué autour du cou . Il ne faisant pas toujours bon d’avoir cette équipe car il y avait souvent des absents et on y trouvait toutes sortes de personnages, allant du « trimard » au « chemineau ». Ils couchaient dans les granges ou les étables la nuit venue. Certains étaient même connus pour leur penchant à la boisson.
Il fallait nourrir tous ces gens. Une grande table était dressée, entourée de bancs. Le travail était dur pour préparer les repas et faire les vaisselles.
Tous ces métiers, toutes ces coutumes revenaient ponctuellement au rythme des années, personne n’aurait pensé à en changer la marche. Mais vint la drôle de guerre . De 1939 à 1945 tout changea. Époque de drames, époque de folies, l’après-guerre arriva où tout était à reconstruire. L’agriculture avait une grande tâche à accomplir, celle de nourrir la France qui n’en pouvait plus de tant de souffrances et de privations. Une autre ère commençait pour le monde rural.